
La rubrique ‘L’actualité en images’ se penche cette fois sur le S&P 500, qui a connu jeudi dernier une correction de cap certes modeste, mais qui n’est pas passée inaperçue. Une saine correction pour les uns, le signal d’alarme d’une catastrophe imminente pour les autres.
Les bourses sont non seulement des indicateurs de capitalisations boursières et de jeux à somme nulle de gagnants et perdants, mais aussi des indicateurs de sentiment. Ce qui monte redescend, et vice versa. À long terme, cependant, le marché boursier est généralement haussier, car il y a de plus en plus d’argent dans le monde et proportionnellement de moins en moins de valeur.
Ces sautes d’humeur se sont encore manifestées cette année dans toute leur splendeur dans le S&P. Après la superbe année boursière 2019, toutes les sonnettes d’alarme ont retenti à la fin de cette année-là, indiquant que la teneur en testostérone du marché était un peu faible et qu’il était sage de réduire un peu le risque, ce qu’ont d’ailleurs fait un certain nombre de banques. Pourtant, la bourse américaine a bondi, atteignant un sommet historique de 3389 points.
C’est alors que le coronavirus est arrivé. Il est devenu un problème lorsque le virus s’est avéré avoir frappé l’Italie de plein fouet, faisant ainsi du problème asiatique un problème européen. La combinaison d’un problème de santé publique (pandémie) et d’un problème économique (lockdown) a massivement poussé les investisseurs sur les marchés vers la sortie. En quatre semaines seulement, le S&P a chuté de plus de 35 %.
Le plancher a été atteint le 23 mars, après que la Réserve fédérale américaine ait annoncé qu’elle soutiendrait les marchés, si nécessaire de manière illimitée. C’est à partir de ces 2192 points que la reprise s’est amorcée. D’abord les actions de qualité, qui répondent à l’acronyme FAANG + M (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google et Microsoft) – suivies plus tard par le marché plus large. En fin de compte, il y a même eu des spéculations sur la reprise d’entreprises de valeur qui avaient touché le fond, et même d’entreprises pratiquement en faillite, comme la société de location de voitures Hertz.
La première vague de ce schéma de cours, selon la théorie des vagues d’Elliott (du nom de son inventeur Ralph Elliot) a atteint 2637 points. Au cours de la deuxième semaine, le compteur est retombé de 2637 à 2447 points. La troisième vague a suivi, traditionnellement très puissante : le S&P a augmenté de plus de 500 points, passant de 2447 à 2955 points. D’où une nouvelle petite baisse, de 2955 à 2767 points. La cinquième vague s’est ensuite amorcée, explique le stratège en macroéconomie mondiale Jurrien Timmer de Fidelity Investments. Cette vague a trouvé un niveau de soutien d’environ 2950 points, ce qui est effectivement la moyenne à 200 jours du S&P.
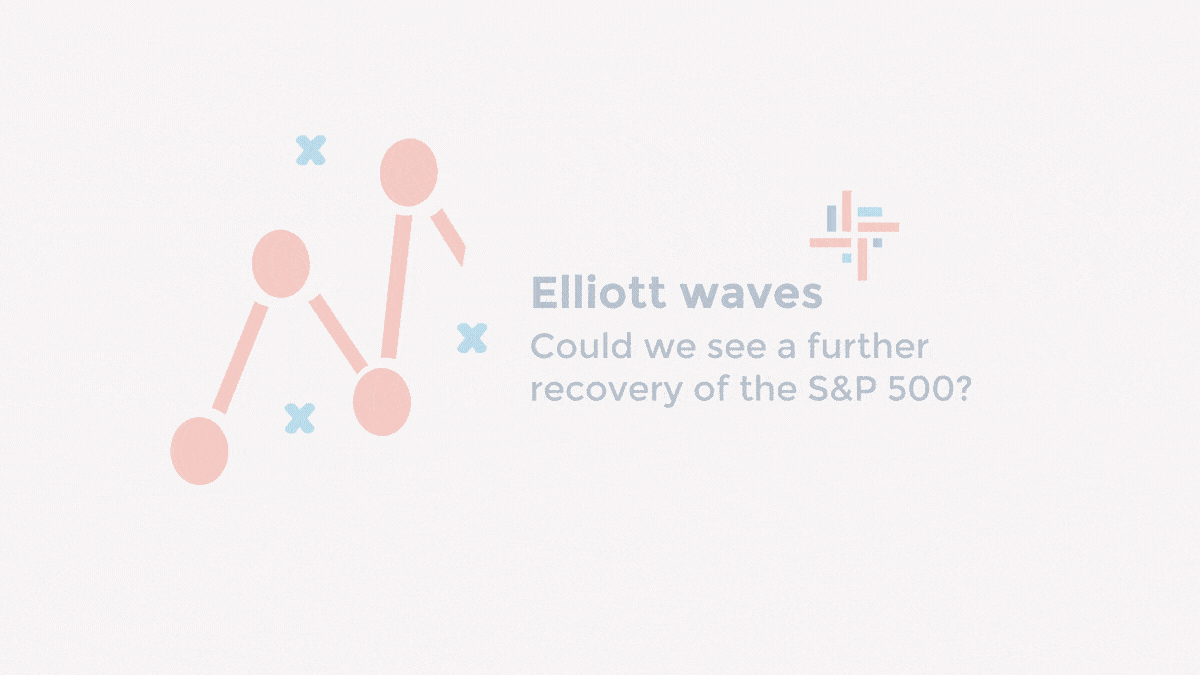
Source : Fidelity. Infographic: Core Digital Strategy
Une petite correction de cours a eu lieu jeudi dernier, mais le S&P semble maintenant s’être repris. Les analystes techniques ont même fixé un objectif de 3233 points. Ce qui est frappant, comme le déclarait Jurrien Timmer dans son entretien avec Fondsnieuws, c’est que l’évolution du cours de cette année est très similaire à celle de 2009. À l’époque, le plancher avait été atteint le 9 mars, après quoi un redressement du cours de plus de 40 % avait suivi en peu de temps. Ensuite, une correction avait supprimé 25 % du gain de cours, après quoi la porte d’un véritable marché haussier avait cependant été ouverte. Il allait durer pas moins de 11 ans.
Théorie des vagues d’Elliott
Selon la théorie de Ralph Elliott, le mouvement est composé de cinq vagues, dont trois sont dans la direction du mouvement et deux dans la direction contraire : la première, la troisième et la cinquième vagues représentent la forme impulsive, et la deuxième et la quatrième vagues, la forme corrective. Selon Elliott, trois règles doivent être respectées : la vague 2 ne peut jamais aller au-dessous de la vague 1 ; la vague 3 ne peut jamais être la plus courte des trois vagues impulsives (1, 3 et 5) ; et la vague 4 ne peut jamais descendre plus bas que le sommet de la vague 1.
Dans l’interview accordée à Fondsnieuws, la plateforme sœur néerlandaise d’Investment Officer, Timmer affirme que les vagues d’Elliot doivent être considérées comme un instrument d’interprétation du marché. La théorie ne dit pas ce qui se passe, mais ce qui peut se passer. Autrement dit, il faut selon lui d’abord la considérer comme un des scénarios envisageables, et toujours l’utiliser en combinaison avec l’analyse fondamentale.
Jaap van Duijn, ancien stratège en investissement de Robeco et auteur du livre ‹Trends en cycli›, estime que l’analyse technique a beaucoup de mérite, mais émet des réserves concernant la théorie de Ralph Elliott.
« Cette théorie ne peut être appliquée qu’aux indices suivis par un grand nombre d’investisseurs et dont les mouvements ne sont pas dérivés de ceux d’autres marchés. Le Dow Jones et le S&P répondent à cette exigence, mais l’AEX néerlandais beaucoup moins », écrit-il dans son livre.
« L’application de la théorie d’Elliott est compliquée dans la pratique, car les différentes étapes de 1 à 5 et les vagues A à C ne sont pas toujours faciles à interpréter. En outre, Elliott a reconnu toutes sortes de schémas supplémentaires qui font de la bonne lecture et interprétation des vagues d’Elliott une véritable épreuve. »
Cependant, l’idée derrière les mouvements des vagues est fascinante, estime l’ancien stratège de Robeco : « l’humeur des masses se développe selon des schémas fixes et rend ainsi les évolutions de cours plus ou moins prévisibles pour l’utilisateur habile du principe des vagues d’Elliott. »
Jaap van Duijn lui-même est particulièrement séduit par le cycle de Kondratieff, qui affirme que depuis le XIXe siècle, l’économie mondiale a connu cinq vagues. Cette dernière vague se trouve maintenant dans sa phase finale.